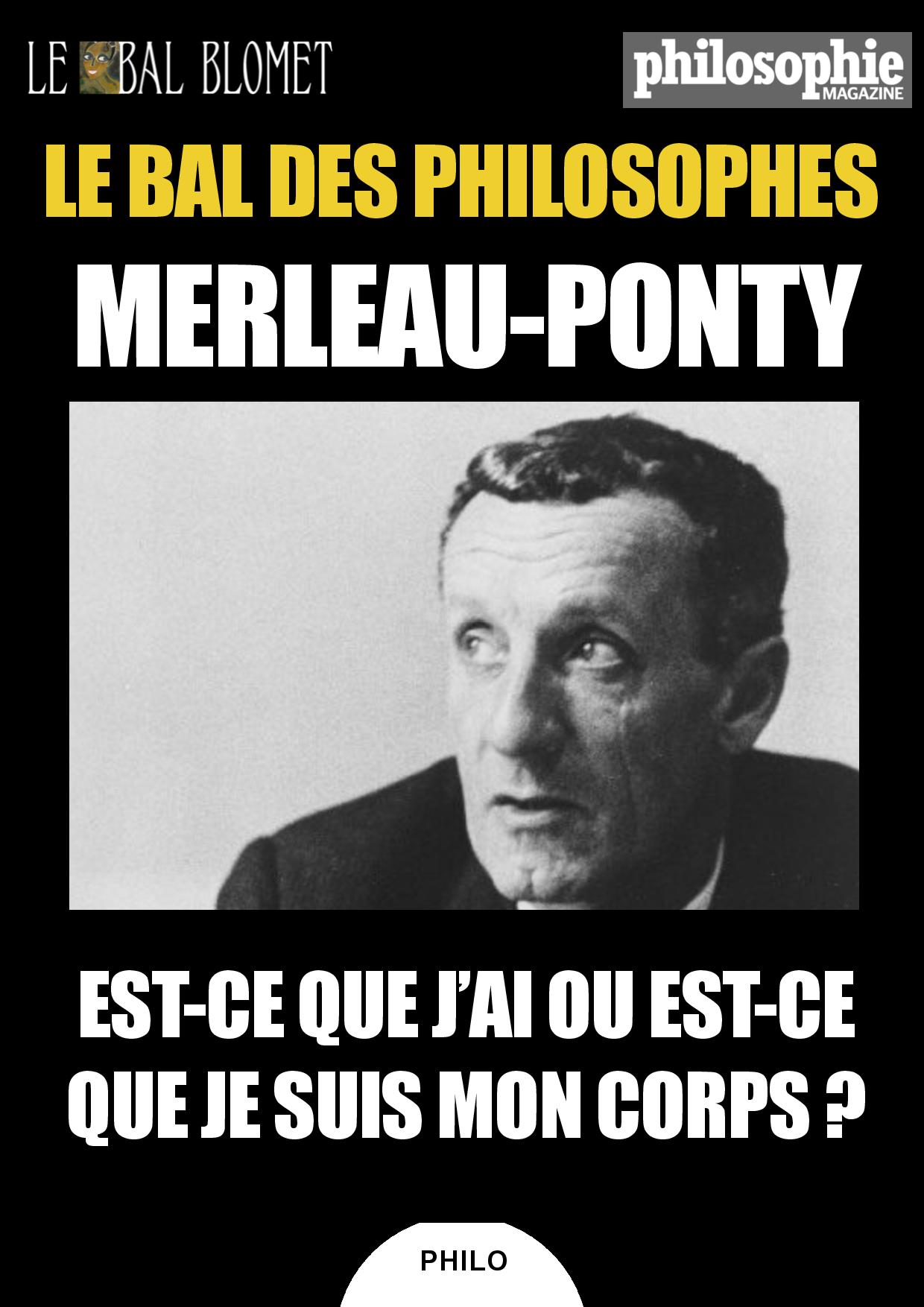
05 Nov LE BAL DES PHILOSOPHES – MERLEAU-PONTY. EST-CE QUE J’AI OU EST-CE QUE JE SUIS MON CORPS ?
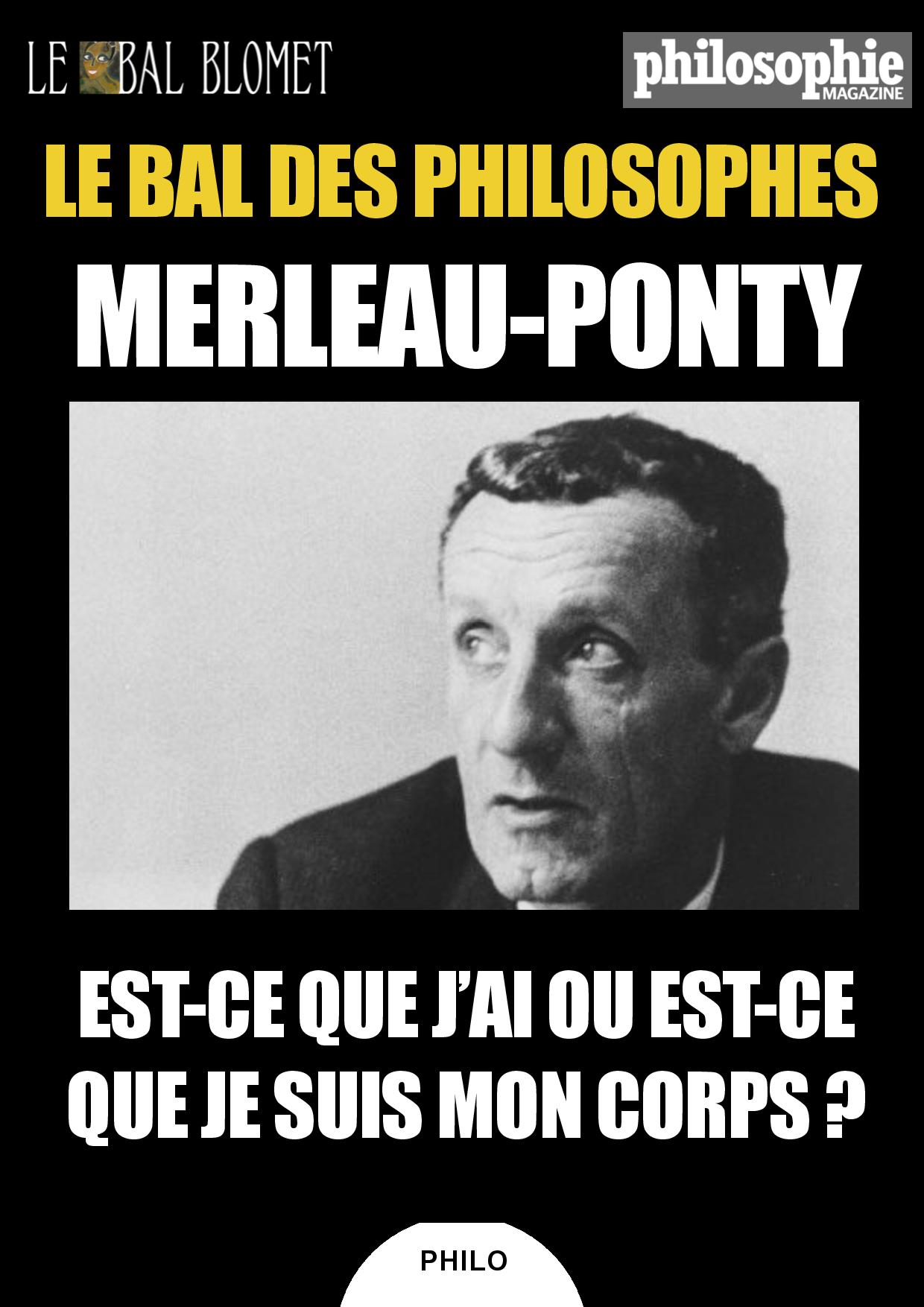
SIX PENSEURS QUI ONT FAIT LE XXe SIÈCLE
Présenté par Martin LEGROS
Piano : Pierre-François BLANCHARD
Six lectures participatives de petits extraits décisifs des grands textes philosophiques du XXe siècle, de NIETZSCHE à SARTRE, accompagnés de musique improvisée. Pour se coltiner en direct et de manière vivante aux grands moments de la philosophie.
Après une courte introduction qui présente le philosophe et l’œuvre du jour, on lit ensemble, ligne à ligne, le texte en essayant d’en comprendre les articulations fondamentales mais aussi les questions qu’il soulève. Tout au long de la séance, Martin Legros incite le public à réagir au texte pour en interroger le sens.
Philosophe et journaliste, Martin Legros est rédacteur en chef de Philosophie magazine et de Philomag.com. Il est l’auteur de Pantopie (Le Pommier), entretiens avec Michel Serres et de Que faire ? Dialogue entre Alain Badiou et Marcel Gauchet (Philosophie magazine Editions), il dirige la collection 20 Penseurs (Philosophie magazine Editeur).
Est-ce que j’ai ou je suis mon corps ?
Dénoncé par Platon comme le grand perturbateur de la vie et de la connaissance, objectivé par Descartes comme une substance étendue, distincte de la substance pensante de l’âme, le corps a été retrouvé au cours de la modernité tardive. Gardien de nos désirs inconscients avec Freud, support de notre mémoire avec Proust, il est pour la phénoménologie le grand intercesseur qui nous met en contact avec nous-même, avec le monde et avec les autres. C’est ce que permet de comprendre cet extrait de L’œil et l’esprit de Merleau-Ponty où le corps apparaît comme le lieu de naissance de la sensibilité et mêmede la pensée.
« L’énigme tient en ceci que mon corps est à la fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes choses, il peut aussi se regarder, et reconnaître dans ce qu’il voit alors l’« autre côté » de sa puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant, il est visible et sensible pour soi-même. C’est un soi, non par transparence, comme la pensée, qui ne pense quoi que ce soit qu’en l’assimilant, en le constituant, en le transformant en pensée – mais un soi par confusion, narcissisme, inhérence de celui qui voit à ce qu’il voit, de celui qui touche à ce qu’il touche, du sentant au senti – un soi donc qui est pris entre des choses, qui a une face et un dos, un passé et un avenir…
Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d’une chose. Mais, puisqu’il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même du corps. Ces renversements, ces antinomies sont diverses manières de dire que la vision est prise ou se fait du milieu des choses, la où un visible se met à voir, devient visible pour soi et par la vision de toutes choses, là où persiste, comme l’eau mère dans le cristal, l’indivision du sentant et du senti.
Cette intériorité-là ne précède pas l’arrangement matériel du corps humain, et pas davantage elle n’en résulte. Si nos yeux étaient faits de telle sorte qu’aucune partie de notre corps ne tombât sous notre regard, ou si quelque malin dispositif, nous laissant libre de promener nos mains sur les choses, nous empêchait de toucher notre corps – ou simplement si, comme certains animaux, nous avions des yeux latéraux, sans recoupement des champs visuels – ce corps qui ne se réfléchirait pas, ne se sentirait pas, ce corps presque adamantin, qui ne serait pas tout a fait chair, ne serait pas non plus un corps d’homme, et il n’y aurait pas d’humanité. Mais l’humanité n’est pas produite comme un effet par nos articulations, par l’implantation de nos yeux (et encore moins par l’existence des miroirs qui pourtant rendent seuls visible pour nous notre corps entier). Ces contingences et d’autres semblables, sans lesquelles il n’y aurait pas d’homme, ne font pas, par simple sommation, qu’il y ait un seul homme. L’animation du corps n’est pas l’assemblage l’une contre l’autre de ses parties – ni d’ailleurs la descente dans l’automate d’un esprit venu d’ailleurs, ce qui supposerait encore que le corps lui-même est sans dedans et sans « soi ».Un corps humain est là quand, entre voyant et visible, entre touchant et touche, entre un œil et l’autre, entre la main et la main se fait une sorte de recroisement, quand s’allume l’étincelle du sentant-sensible, quand prend ce feu qui ne cessera pas de brûler, jusqu’à ce que tel accident du corps défasse ce que nul accident n’aurait suffi à faire… »
(L’œil et l’esprit, pp. 12-15, Gallimard, 1960).

